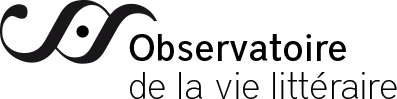Université d’été | Bi-licence "Lettres – Informatique" | Ateliers
PAGE ACCUEIL
Entretien avec Antoine Compagnon
Entretien avec Antoine Compagnon

À l’occasion de la mise en ligne d’une version française de sa conférence « La résistance à l’interprétation », Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et à l’université Columbia, a accepté de revenir sur son analyse des évolutions de la recherche en littérature à l’âge du numérique.
Dans quelles circonstances votre conférence « The Resistance to Interpretation », dont nous publions une traduction française sur ce site, a-t-elle été organisée ?
Antoine Compagnon
J’ai fait cette conférence à l’occasion d’un colloque à Charlottesville (« Interpretation and Its Rivals », colloque de l’University of Virginia, le 19 septembre 2013), qui se donnait pour ambition de dresser un état de la recherche sur les questions d’interprétation. Le titre « La résistance à l’interprétation » est une allusion à un article célèbre de Paul de Man, « The Resistance to Theory » (publié dans la revue Yale French Studies, n° 63, 1982, p. 3-20). Paul de Man y montre que la résistance à la théorie est inhérente à la théorie et, par conséquent, qu’il n’y a pas de théorie sans résistance à la théorie. Il me semblait intéressant d’interroger, en termes comparables, l’état présent de l’interprétation et, dans le même temps, une certaine résistance à l’interprétation qui est assez récurrente chez les littéraires. L’interprétation a ses dangers. C’est pourquoi l’on préfère parfois éviter d’interpréter. Cela explique les succès de certaines méthodes (historiques, formelles, etc.) qui permettent de faire autre chose que d’interpréter la littérature.
Vous utilisez la métaphore de la chasse pour définir la recherche en littérature. On peut mettre cette métaphore en relation avec vos travaux actuels, sur une certaine forme d’anthropologie de la littérature. Quelle place la métaphore de la chasse a-t-elle tenu dans votre enseignement ?
Antoine Compagnon
J’ai toujours considéré que le chercheur devait être une sorte de chasseur. Quand je reçois des étudiants qui commencent une recherche, à la Sorbonne ou ailleurs, j’essaye d’évaluer cette sorte d’instinct du chasseur qu’il doit y avoir en tout chercheur, parce qu’il ne suffit pas d’aller en bibliothèque et de lire des textes : il faut savoir cultiver sa disposition à la recherche. Les meilleurs étudiants que j’ai dirigés, en France et aux États-Unis, avaient une sorte de bonheur de la bibliothèque. Ils en revenaient toujours avec quelque chose, comme des chasseurs avec leur prise. Évidemment, les conditions de travail et les méthodes de la recherche ont beaucoup évolué. Pour les gens de ma génération, qui ont commencé il y a trente ans ou quarante ans, le travail en bibliothèque a représenté un temps considérable, qu’il est difficile d’imaginer aujourd’hui. Je crois que ma génération a eu de la chance. Elle a connu le meilleur de la culture physique et a su, sans renoncer à cette culture, passer à la culture numérique. Elle est passée du livre physique au livre numérique, tout en conservant quelque chose de l’approche du chasseur, qui consiste à savoir ce qu’on peut chercher et où le chercher. Les nouvelles générations n’ont pas le même enracinement dans la culture du livre physique, dans celle de la bibliothèque et du magasin de bibliothèque. J’ai eu de grands moments de bonheur dans les magasins de la Sorbonne, qui étaient pourtant dans un beau désordre. Il n’y avait pas vraiment de classification. C’était une sorte d’errance dans les livres, qui a pu s’avérer très fructueuse. Sur internet on erre, mais on erre de manière très différente.
Vous êtes soucieux de mettre en garde les enseignants chercheurs contre les excès de démarches scientifiques contemporaines. Ainsi vous avez montré les impasses de ce que vous avez appelé le « démon de la théorie ». Et vous utilisez également des termes forts, comme « menace » ou « danger », à l’égard de certains aspects des humanités numériques.
Antoine Compagnon
Les recherches en humanités numériques, dans un grand nombre de cas jusqu’à aujourd’hui, ont permis de confirmer des thèses qui avaient été déjà formulées, relatives par exemple à des problèmes d’attribution. Il ne faut pas négliger cette contribution. C’est un apport tout à fait sérieux de pouvoir constater, de manière indépendante et objective, qu’un certain nombre d’interprétations, c’est-à-dire d’hypothèses interprétatives, peuvent être confirmées indépendamment de l’observateur. Ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, avec ces méthodes, c’est que l’on peut aborder les textes littéraires dans le big data, sans hypothèses préalables, et que les hypothèses se dégagent d’elles-mêmes d’algorithmes qui rendent manifestes des phénomènes de récurrence. Au fond, le b.a.-ba des humanités numériques reste la « méthode des passages parallèles », qui consiste à chercher des récurrences à partir d’hypothèses de cohérence. J’insistais déjà sur cette méthode dans mon cours de théorie à la Sorbonne et dans Le Démon de la théorie. L’informatique permet de mener une recherche neutre, dans la mesure où les récurrences se dégagent des données indépendamment des hypothèses. Cependant, la tentation, c’est de ne plus lire. Ce que Franco Moretti appelle « distant reading » permet de mener des recherches sur la littérature sans lire. En réalité, ce n’est pas nouveau. On a pu faire dans le passé des travaux d’histoire littéraire qui ne supposaient pas beaucoup de lecture des textes. La résistance à l’interprétation se situe là. L’interprétation est risquée. En l’évitant, on s’épargne cette prise de risque. Or, le risque avec les humanités numériques, c’est de se réfugier dans des méthodes qui évitent la confrontation avec la littérature.
Dans votre conférence, vous évoquez la grâce pascalienne et une forme de jansénisme de la recherche littéraire, fondé sur une faculté à formuler des intuitions, à les projeter sur des textes et à les vérifier. Cette démarche vous semble-t-elle incompatible avec le numérique, qui prétend à une forme d’objectivation ?
Antoine Compagnon
Il y a une sorte de circularité herméneutique, que l’on peut en effet comparer à la grâce pascalienne : « Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé. » Ce mouvement est celui du chercheur en bibliothèque, qui ne cesse de confirmer ou de contester des hypothèses qu’il a faites. La manière dont j’utilise des bases de données dans mon travail me donne l’impression de pouvoir continuer à procéder par ce type de démarche. Il est vrai que l’on peut travailler aujourd’hui avec des corpus beaucoup plus étendus et qui intègrent des textes moins connus. Je travaille beaucoup avec des bases de données et j’en tire énormément de choses. Le cours que j’ai fait l’an dernier sur le chiffonnier du xixe siècle est fondé sur des corpus littéraires, des corpus de presse, des corpus d’images, auxquels on peut avoir facilement accès aujourd’hui. Ce sont des cours qui n’étaient pas faisables tels quels auparavant. Et je crois que nous sommes nombreux aujourd’hui à travailler sur des objets que nous n’aurions pas pu étudier il y a quelques années.
Les réticences face aux humanités numériques ne reposent-elles pas également sur le fait que le domaine est très dépendant de la linguistique et des TAL (Traitements Automatiques de la Langue), et que la place occupée par la sémantique, par le singulier et par la singularité d’un texte, qui sont plutôt du domaine des littéraires, est relativement réduite dans de nombreuses méthodologies appliquées par le numérique ?
Antoine Compagnon
Dans cette conférence, j’insiste sur le fait que le domaine le plus productif, dans le numérique, est celui qui s’intéresse aux mots les moins signifiants. Il s’agit d’un aspect que, justement, nous ne pouvons pas prendre en compte, nous lecteurs, puisque ce ne sont pas les mots outils d’un texte qui retiennent notre attention, mais les mots lexicaux. Et pourtant, c’est à partir de ce calcul sur ce qu’il y a de plus insignifiant dans un texte que l’on peut repérer un style individuel et même un genre. Un apport considérable des humanités numériques est d’avoir montré que le genre réside dans la phrase. Je reconnais que la découverte heurte certains principes. Que le genre réside dans la phrase, qu’il puisse exister dans les mots outils de la phrase davantage que dans les mots significatifs et dans les mots lexicaux du point de vue de la subjectivité et de l’identité, c’est troublant pour l’interprétation littéraire. Mais les humanités numériques se heurtent, en retour, au problème des textes outliers, des « données aberrantes », qui n’entrent pas dans les statistiques. Ces textes-là, un statisticien a tendance à ne pas les considérer, puisque leur réalité n’a pas de sens pour lui. Pour les littéraires, au contraire, ils sont intéressants précisément dans leur dimension de outlier. On a reproché au formalisme de ne pas s’intéresser aux textes dans leur individualité et d’aller vers des généralités et des universalités. On peut faire le même reproche aux humanités numériques : la littérature réside-t-elle dans la singularité des textes ? Tout texte est-il singulier ? Faut-il s’intéresser aux formes, aux genres, à tout ce que l’on peut tirer comme corrélations à partir des genres ? Un littéraire choisit le plus souvent de s’intéresser à un texte en raison de sa singularité. C’est à ce titre que nous admettons les notions de canon ou de valeur littéraire. Élargir le corpus, remettre en cause le canon, travailler à partir de bases de données où les textes sont mis à plat, ce ne sont pas de mauvaises choses. Cependant, quand, en consultant une base de données, on tombe sur un texte de Chateaubriand ou de Claudel, soudain on se dit qu’il y a une autre respiration qui surgit.
Propos recueillis par Didier Alexandre et Marc Douguet
Lire le texte de la conférence « La résistance à l’interprétation »