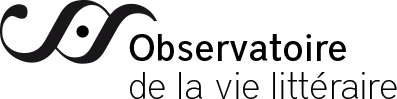Université d’été | Bi-licence "Lettres – Informatique" | Ateliers
PAGE ACCUEIL
Entretien avec Michel Murat
Entretien avec Michel Murat
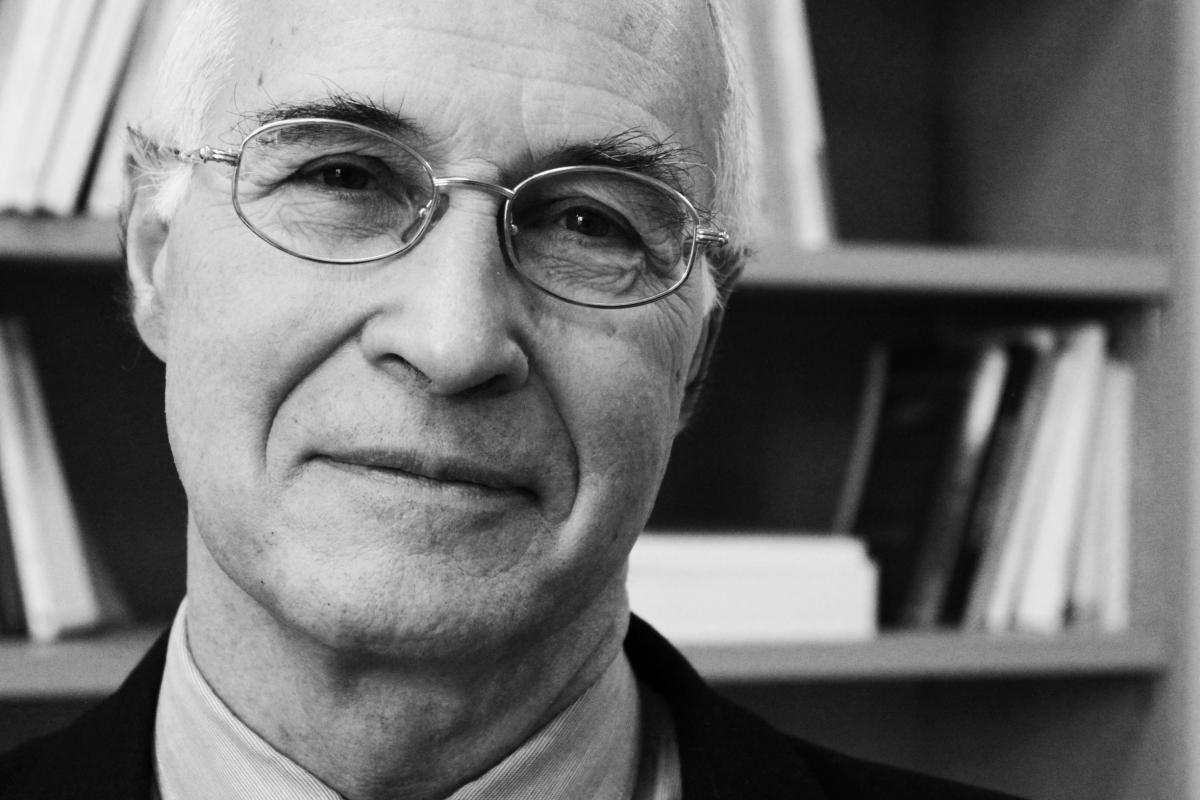
Michel Murat est professeur de littérature française à l’Université Paris-Sorbonne. Spécialiste de la poésie des XIXe et XXe siècles, il participe à plusieurs projets au sein de l’OBVIL. Il nous présente les différents chantiers sur lesquels il travaille, notamment l’« HyperApollinaire » et un tout nouveau projet consacré aux archives sonores de la poésie.
Vous coordonnez le projet « HyperApollinaire » avec Didier Alexandre et Laurence Campa. Pourriez-vous nous rappeler les objectifs scientifiques de ce projet ?
Le projet HyperApollinaire est pour partie issu d’une entreprise éditoriale papier qui a buté sur des obstacles juridiques. Didier Alexandre et moi avions été sollicités par Le Livre de Poche pour publier un « Pochothèque » d’Apollinaire au moment où l’œuvre est tombée dans le domaine public, mais il s’est avéré que Gallimard bloquait certaines publications, en particulier pour les Lettres à Lou. Les raisons juridiques étaient contestables, mais Le Livre de Poche n’a pas voulu risquer une action offensive. Nous nous sommes donc retrouvés avec un travail qui était déjà fait. Le meilleur lieu pour le publier, c’était le projet « HyperApollinaire ». Nous voulions opérer une reconfiguration de l’œuvre d’Apollinaire qui la fasse échapper à l’image habituelle que nous en avons, et qui voit dans Apollinaire avant tout l’auteur d’Alcools, puis, en second plan, de Calligrammes, et qui relègue à l’arrière-plan ses récits, comme une sorte de fantaisie, et place encore plus loin sa critique d’art et sa critique journalistique. Nous souhaitions également repenser l’ensemble de l’œuvre poétique en reclassant les textes par ordre chronologique et en faisant apparaître le rapport entre les textes publiés dans les grands recueils, les prépublications dans des revues et des textes qui apparaissent dans des correspondances privées et qui ont émergé beaucoup plus tard. Par exemple, les poèmes qui composent Alcools ont pour la plupart été publiés auparavant en revue, dans des versions ponctuées : Apollinaire n’a supprimé la ponctuation que sur les secondes épreuves, à la fin de 1912. Dans l’HyperApollinaire, le lecteur aura accès à l’intégralité des versions successives d’un même texte et pourra circuler de l’une à l’autre et les mettre en regard, à la différence des éditions papier qui ne donnent la plupart du temps que des variantes. Il a nous donc semblé que l’outil numérique était particulièrement bien adapté pour une œuvre comme celle-là, car il permet de circuler dans la chronologie et de recomposer les ensembles en fonction des demandes et des intérêts de l’usager.
C’est un travail considérable, qui revient à faire une édition complète d’Apollinaire, et pour lequel nous avons réuni une vraie équipe, avec les meilleurs chercheurs. À l’heure actuelle nous avons terminé l’édition du texte, et nous pouvons dire que nous proposons sur le site de l’OBVIL le meilleur texte disponible. Il n’y a pas grand chose à dire pour les grands recueils, qui étaient déjà bien édités, mais, pour les textes critiques et journalistiques, nous sommes retournés à la source et nous avons corrigé beaucoup de choses. Nous nous sommes aussi posé beaucoup de problèmes pratiques pour Calligrammes, qui est constitué à la fois de textes, qu’il suffit de ressaisir et de remettre en page, mais aussi de compositions typographiques, comme « Lettre-océan » ou « Voyage », et de manuscrits photocomposés. Nous avons inséré dans le texte les images en les remettant à leur place et nous avons établi des transcriptions. Nous disposons donc à la fois de l’image et de l’équivalent textuel, qui constitue un support nécessaire pour l’annotation.
Il nous reste à assurer et surtout à homogénéiser l’annotation, car une partie du travail a été fait en ordre dispersé. L’étape suivante sera la mise en connexion d’un réseau d’images et de documents, dans une perspective hypertextuelle et transmédiale. Cette entreprise va être menée à bien par Didier Alexandre dans le cadre d’un second projet Apollinaire, mené en partenariat avec l’INA. Ce projet, dans le détail duquel je n’ai pas à entrer ici, vise à créer un outil de communication et de monstration de l’œuvre tout à fait inédit, différent d’une édition hypertextuelle.
Au-delà de la simple numérisation, le corpus « HyperApollinaire » est destiné à être analysé à l’aide d’outils numérique. Quelles méthodes comptez-vous employer ?
Il y a trois phases dans le projet : un phase d’édition, une phase d’enrichissement contextuel et documentaire, et une phase d’interprétation. Pour cette dernière, nous souhaitons faire deux choses. D’une part, se servir de l’HyperApollinaire pour donner accès à un état de la critique : il ne s’agira pas de reproduire la totalité de la critique apollinarienne, mais de renvoyer, pour chaque poème, à des publications papier ou en ligne. Je pense par exemple à la revue Que vlo-ve ?, revue d’études apollinariennes dont les archives sont disponibles en ligne.
Après, nous entrons dans l’inconnu, c’est-à-dire dans des procédures d’analyse numérique que nous maîtrisons en partie mais qui n’appartiennent pas vraiment à notre culture, qui est plus qualitative. Il nous arrive en effet de travailler sur de très gros corpus, mais nous essayons d’abord de les maîtriser, et de travailler à partir d’échantillons. Nous ne sommes pas formés à travailler sur des données massives. Un des intérêts de l’HyperApollinaire, c’est que nous y sommes obligés. Nous allons notamment construire une « ontologie » du discours critique d’Apollinaire, c’est-à-dire un système de description qui permet d’interroger un corpus. Il en a été question dans un article que j’ai écrit avec Olivier Gallet, Laure Michel et Christophe Pradeau pour un numéro de la Revue d’histoire littéraire de la France. Nous avons essayé plusieurs configurations, soit en construisant des arborescences sémantiques, soit en prenant au contraire des points de départ empiriques et en partant d’une analyse lexicale des textes eux-mêmes. Je pense que les deux sont pertinents.
Il y a là des enjeux très intéressants, d’abord parce qu’aucune ontologie de ce genre n’existe. Cela permettra de comprendre le fonctionnement du discours critique chez Apollinaire et, au-delà, de modéliser le discours critique en général, au moins pour la période qui nous concerne, c’est-à-dire une période post-rhétorique. Essayer de créer et de faire fonctionner une ontologie, même modeste, nous donnera un premier élément qui nous permettra ensuite d’élargir cette interrogation aux autres bases de données textuelles dont nous disposons, en particulier à la bibliothèque critique de l’OBVIL, qui correspond bien à la période concernée, puisqu’elle va pour l’essentiel de 1860 à 1940.
Lorsqu’on sait quelles questions poser à la machine, des résultats sont obtenus très vite ; c’est la construction des questions qui est vraiment difficile, davantage même que l’interprétation des résultats. L’autre difficulté est que les énoncés d’Apollinaire eux-mêmes sont souvent très complexes et difficiles à traiter. J’ai cité comme exemple un passage où Apollinaire parle de Cézanne :en quelques mots il en dit à la fois du bien et du mal. Si on pose à la machine une question de base, par exemple : « Apollinaire pensait-il que Cézanne était un grand peintre ? », la machine va nous répondre à la fois oui et non. Ce n’est pas un hasard, et c’est là que l’on retrouve l’analyse qualitative, puisqu’on voit l’embarras d’Apollinaire vis-à-vis de Cézanne, dont il ne sait pas très bien quoi penser.
C’est aussi un travail complexe parce qu’il nous faut le mener à la fois à partir de nos propres interrogations, et en concertation avec les ingénieurs de recherche : nous devons sans cesse vérifier que nos hypothèses sont traductibles en langage machine. Parfois il faut les abandonner, parfois il vaut mieux les reformater ou les réajuster. Nous sommes actuellement dans cette phase de test. Il faudra, dans l’année qui vient, faire un choix entre deux ou trois hypothèses de départ et engager un protocole véritablement expérimental.
Le projet « HyperApollinaire » n’est pas le seul auquel vous participez au sein de l’OBVIL…
Je me trouve, de fait, dans trois ou quatre endroits du labex. Je suis de près le projet « HyperPaulhan », qui est coordonné par Camille Koskas, une de mes doctorantes, et Clarisse Barthélémy, qui était une doctorante de Didier Alexandre. C’est un projet tout à fait différent. La conception éditoriale est voisine, puisque notre but est de produire une correspondance générale de Jean Paulhan classée par ordre chronologique, avec la possibilité de sélectionner les lettres par destinataire, et de recomposer les ensembles. La différence est que les textes ne sont pas dans le domaine public et que tout se fait en partenariat étroit avec l’IMEC, avec Claire Paulhan, qui est la petite-fille de Jean Paulhan et son ayant-droit, avec la Société des lecteurs de Jean Paulhan, et avec les éditions Gallimard. Tout n’est pas encore arbitré, mais nous fonctionnons depuis le début sur la base d’une concertation large. Pour le moment nous avons mis au point un protocole de numérisation et d’édition que je trouve d’une grande qualité, avec l’image numérisée et la transcription en regard. Il reste à annoter le corpus. J’ai réussi à faire travailler mes étudiants de master et à créer une petite équipe que Camille Koskas a formée et qui va régulièrement à l’IMEC pour continuer la transcription. Du point de vue des contrats doctoraux, c’est aussi un bon exemple, puisque Camille Koskas a mené un programme dans le cadre du labex tout en faisant une thèse « classique », qui porte sur Paulhan et la NRF durant l’après-guerre.
Enfin, j’ai participé depuis le début au projet de Françoise Waquet « Oraliser la littérature ». À l’intérieur de cette équipe, un nouveau chantier s’est dessiné, qui concerne les archives sonores de la poésie. Nous en avons pris conscience lorsqu’Abigail Lang et Jean-François Puff ont présenté le dossier des lectures organisées par Emmanuel Hocquard à l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. 1000 pages de programme papier, des dizaines d’œuvres, une centaine d’enregistrements conservés : tout un fonds d’archives sonores ! Nous avons commencé à réfléchir autour de cette question et nous nous sommes aperçus que, de par son volume et son ampleur, ce programme ne pouvait pas être seulement un élément du programme « Oraliser la littérature », qui a sa logique propre (il doit aboutir à une publication collective, à laquelle nous participerons). Nous avons donc décidé de l’externaliser. Il se trouve aussi que nous avions déjà monté un projet de colloque sur les archives sonores de la poésie avec Abigail Lang et Céline Pardo, mon ancienne étudiante, qui avait travaillé sur la poésie et la radio, et que, parmi les nouveaux post-doctorants qui ont intégré le labex cette année, il y a Yan Rucar, qui a travaillé sur le livre numérique. C’était l’occasion de monter un nouveau programme au sein du labex, qui rejoint parfaitement la dimension patrimoniale de l’OBVIL.
Le colloque s’est tenu fin novembre, et nous sommes maintenant dans une sorte d’effervescence : beaucoup d’acteurs se manifestent et beaucoup de croisements sont en train de se faire. Nous développons un programme d’action et de numérisation afin de partager notre travail et de rechercher ce qui s’est fait ailleurs. Par exemple, nous nous apercevons que les spécialistes d’art du spectacle sont eux aussi en train d’intégrer les archives sonores et audiovisuelles à leur propre réflexion disciplinaire. La situation dans laquelle nous nous trouvons est un peu la même. Plusieurs chantiers sont ouverts. Il faut constituer un portail permettant de présenter les archives sonores, avec un corpus qui couvre tout un siècle, depuis la création des Archives de la parole en 1913, et qui concerne aussi bien les lectures de poésie adossées à du texte imprimé, qui est un modèle très courant, que le courant particulier de la poésie dite « sonore », de la « poésie performée », de la « poésie action » – un courant transmédial, qui circule entre les arts du spectacle, les arts plastiques et la littérature. Des questions de conservation et d’inventaire se posent également, et nous devons passer des accords avec les partenaires institutionnels. Et puis il y a tout un travail à faire pour intégrer cette dimension sonore de la poésie contemporaine dans notre propre réflexion intellectuelle.
Propos recueillis le 6 décembre 2016 par Marc Douguet
Image : ©Marc Douguet